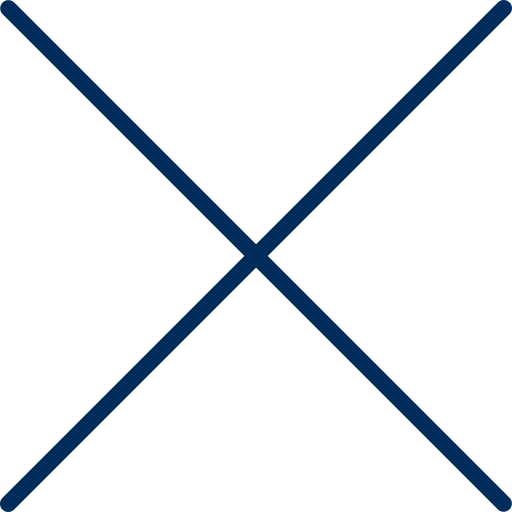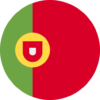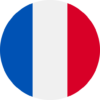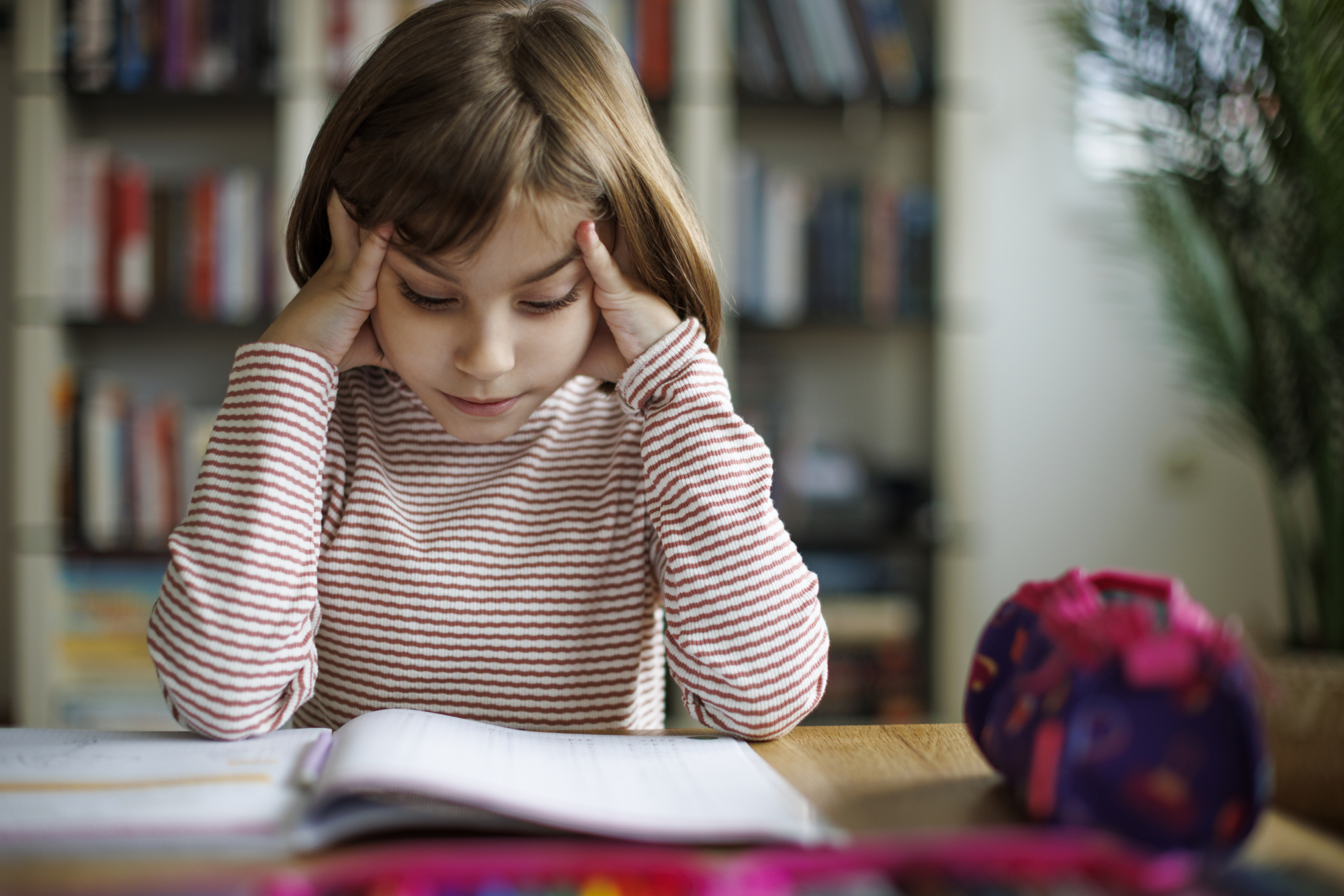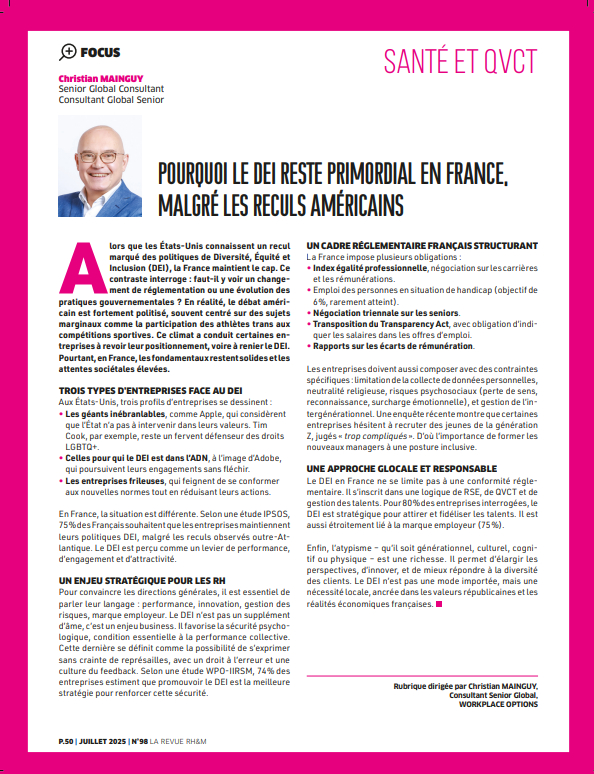LA REVUE RH&M N°98 | JUILLET 2025
Alors que les États-Unis connaissent un recul marqué des politiques de Diversité, Équité et Inclusion (DEI), la France maintient le cap. Ce contraste interroge : faut-il y voir un changement de réglementation ou une évolution des pratiques gouvernementales ? En réalité, le débat américain est fortement politisé, souvent centré sur des sujets marginaux comme la participation des athlètes trans aux compétitions sportives. Ce climat a conduit certaines entreprises à revoir leur positionnement, voire à renier le DEI. Pourtant, en France, les fondamentaux restent solides et les attentes sociétales élevées.
TROIS TYPES D’ENTREPRISES FACE AU DEI
Aux États-Unis, trois profils d’entreprises se dessinent :
- Les géants inébranlables, comme Apple, qui considèrent que l’État n’a pas à intervenir dans leurs valeurs. Tim Cook, par exemple, reste un fervent défenseur des droits LGBTQ+.
- Celles pour qui le DEI est dans l’ADN, à l’image d’Adobe, qui poursuivent leurs engagements sans fléchir.
- Les entreprises frileuses, qui feignent de se conformer aux nouvelles normes tout en réduisant leurs actions.
En France, la situation est différente. Selon une étude IPSOS, 75% des Français souhaitent que les entreprises maintiennent leurs politiques DEI, malgré les reculs observés outre-Atlantique. Le DEI est perçu comme un levier de performance, d’engagement et d’attractivité.
UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES RH
Pour convaincre les directions générales, il est essentiel de parler leur langage : performance, innovation, gestion des risques, marque employeur. Le DEI n’est pas un supplément d’âme, c’est un enjeu business. Il favorise la sécurité psychologique, condition essentielle à la performance collective. Cette dernière se définit comme la possibilité de s’exprimer sans crainte de représailles, avec un droit à l’erreur et une culture du feedback. Selon une étude WPO-IIRSM, 74% des entreprises estiment que promouvoir le DEI est la meilleure stratégie pour renforcer cette sécurité.
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS STRUCTURANT
La France impose plusieurs obligations :
- Index égalité professionnelle, négociation sur les carrières et les rémunérations.
- Emploi des personnes en situation de handicap (objectif de 6%, rarement atteint).
- Négociation triennale sur les seniors.
- Transposition du Transparency Act, avec obligation d’indiquer les salaires dans les offres d’emploi.
- Rapports sur les écarts de rémunération.
Les entreprises doivent aussi composer avec des contraintes spécifiques : limitation de la collecte de données personnelles, neutralité religieuse, risques psychosociaux (perte de sens, reconnaissance, surcharge émotionnelle), et gestion de l’intergénérationnel. Une enquête récente montre que certaines entreprises hésitent à recruter des jeunes de la génération Z, jugés « trop compliqués ». D’où l’importance de former les nouveaux managers à une posture inclusive.
UNE APPROCHE GLOCALE ET RESPONSABLE
Le DEI en France ne se limite pas à une conformité réglementaire. Il s’inscrit dans une logique de RSE, de QVCT et de gestion des talents. Pour 80% des entreprises interrogées, le DEI est stratégique pour attirer et fidéliser les talents. Il est aussi étroitement lié à la marque employeur (75%).
Enfin, l’atypisme – qu’il soit générationnel, culturel, cognitif ou physique – est une richesse. Il permet d’élargir les perspectives, d’innover, et de mieux répondre à la diversité des clients. Le DEI n’est pas une mode importée, mais une nécessité locale, ancrée dans les valeurs républicaines et les réalités économiques françaises.